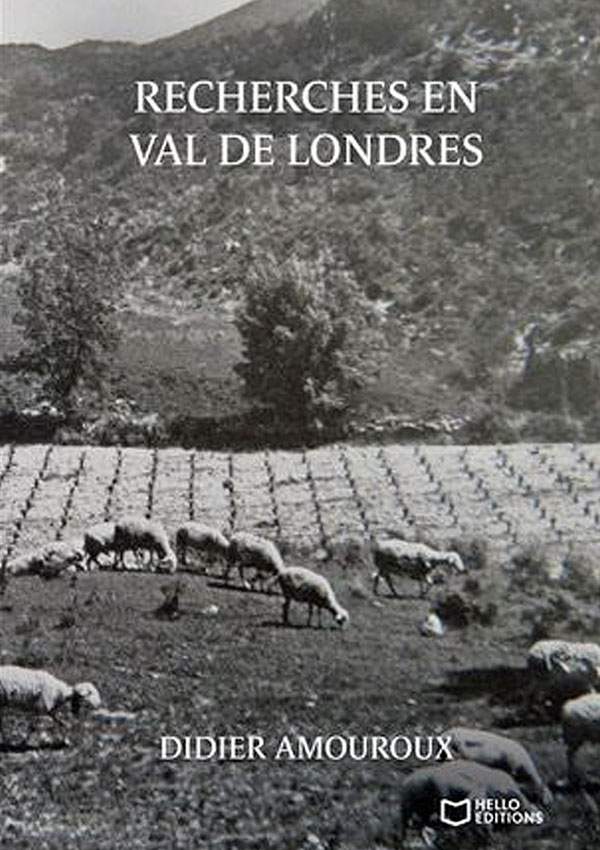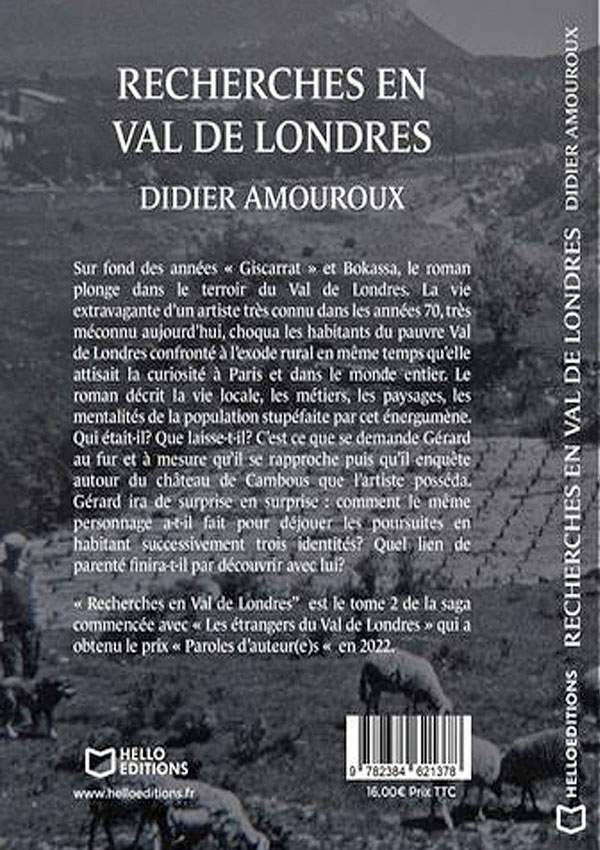Recherches en Val-De-Londres
► Extrait 3
► Extrait 4
► Extrait 5
Recherches en Val-De-Londres
Présentation
Sur fond des années « Giscarrat » et Bokassa, le roman plonge dans le terroir du Val de Londres. La vie extravagante d’un artiste très connu dans les années 70, très méconnu aujourd’hui, choqua les habitants du pauvre Val de Londres confronté à l’exode rural en même temps qu’elle attisait la curiosité à Paris et dans le monde entier.
Le roman décrit la vie locale, les métiers, les paysages, les mentalités de la population stupéfaite par cet énergumène. Qui était-il? Que laisse-t-il? C’est ce que se demande Gérard au fur et à mesure qu’il se rapproche puis qu’il enquête autour du château de Cambous que l’artiste posséda. Gérard ira de surprise en surprise : comment le même personnage a-t-il fait pour déjouer les poursuites en habitant successivement trois identités? Quel lien de parenté finira-t-il par découvrir avec lui?
Recherches en Val de Londres est le tome 2 de la saga commencée avec « Les étrangers du Val de Londres » qui a obtenu le prix « Paroles d’auteur(e)s « en 2022.
Extrait 1 – BOKASSA et Olivier BRICE
Bokassa avait été exfiltré vers la France et la Centrafrique était redevenue une République.
Un jour, les services secrets cessèrent de l’alimenter en valises de billets de 500 F qu’il dilapidait à pleines mains. Comme Brice, son alter ego. Tous deux étaient fantasques, frimeurs, dépensiers. Ils picolaient. Vin rouge et whisky coulaient à flots. Pas le champagne, le nègre n’aimait pas les bulles. Connaissant son penchant depuis son séjour à Bangui, Brice lui offrait midi et soir du Côtes du Rhône, du Chivas et du J&B, ses marques de whisky préférées.
De drôles de zigottos, je t’assure. Des gens qui pétaient plus haut que leurs culs.
Bokassa était un soldat monté en grade qui avait marché droit tant qu’il était encadré par la hiérarchie militaire française. Bombardé chef d’état major de l’armée Centrafricaine à son retour au pays, il avait écrasé de son mépris les militaires africains moins expérimentés que lui. Il avait réussi son coup d’État. Il avait la mainmise sur les richesses enfouies sous la terre désolée. L’ivresse du pouvoir s’était emparée de lui. Il s’attribua successivement les titres de «Président à vie », « Maréchal », « Empereur ». Certain de bientôt égaler Napoléon I auquel il avait emprunté son emblème (un lourd collier ornait son cou de l’aigle royal; il avait fait ériger des statues d’aigle, toutes en or fin, qu’il avait placées partout le jour de son sacre, sur le carrosse, au-dessus du trône, le long des avenues «Bokassa » et « Giscard d’Estaing »), il puisait dans les caisses et dépensait sans compter, massacrant ses opposants, adultes comme enfants venus manifester contre le port obligatoire d’un uniforme payant. Un tyran ordinaire, cupide et prétentieux, autoritaire, capricieux, dépensier. Brice était son double français. Pas dans le genre militaire tu l’as compris. Dans les prétentions artistiques. Aussi convaincu de son génie que l’était Bokassa, il était excessif, comme lui. Le marché du sacre l’avait rendu riche à millions, oui, mais n’avait pas consacré son talent. Les commentateurs s’étaient moqués du carrosse, du baldaquin, du décor super kitsch planté par Brice promu au rang d’ordonnateur des pompes impériales. Le décor d’opérette avait fait rigoler les Européens. Aucun n’avait attribué à Brice la paternité des magnifiques tenues d’apparat (elles étaient signées Lanvin) ou les bijoux- une couronne et un immense sceptre, les deux en diamants étincelants (conçus et montés par le bijoutier Artus Bertrand). Ça ne l’empêchait pas de se les attribuer, il clamait qu’il en était le créateur mais qu’il avait dû laisser Lanvin et Artus Bertrand apposer leurs signatures, histoire de notoriété. Il était menteur, en plus! C’était un usurpateur ce type, un m’as-tu-vu.
Même pas foutu de payer ses créanciers. Avec tout l’argent qu’il avait gagné! Il avait jeté le fric par les fenêtres sous les yeux ébahis des agriculteurs ruinés par les gels successifs et ceux des troupeliers conduits à se séparer de leurs moutons à cause de la chute brutale des cours décidée par Paris. La misère régnait dans les années 70. La population active filait à la ville s’embaucher dans les hôpitaux qui venaient de s’installer au nord de Montpellier ou dans les banques, elles recrutaient à tour de bras. Du coup, les écoles se vidaient, la campagne mourrait à petit feu. C’était l’exode rural. Comment veux-tu que les petites gens vivant misérablement admettent que ce nouveau riche
gaspille sa fortune acquise en léchant les bottes d’un tyran africain? Un jean-foutre, c’est ce que tout le monde pensait de lui.
Extrait 2 – Pas d’EPADH, non, merci…
Gérard informa la dame de son souhait de revenir. Ou plutôt il lui proposa un échange : elle l’autorisait à descendre à nouveau sous la terre; il porterait des poids trop lourds pour son âge, bûches ou meubles à son gré.
Marché conclu, répondit-elle sans poser de question.
Elle paraissait heureuse de ce troc. Elle désirait plus que tout rester autonome.
À 85 ans passés, avec cet escalier à monter et descendre, tout le monde me dit que c’est pas raisonnable. Les voisines insistent pour que j’aille en maison de retraite. Elles auraient déjà réservé une chambre, il paraît que c’est tellement demandé qu’il faudrait s’y prendre des mois à l’avance. Si c’est si bien que ce qu’elles disent, elles ont qu’à y aller, elles! Moi, je veux rester libre, faire ce qui me plait. Oh, je fais pas grand chose, mais je prends l’air quand j’en ai envie, je fais mes petites courses à l’épicerie du village, à la boulangerie, à la boucherie, c’est une promenade agréable et je croise plein de gens, je papote, j’apprends les nouvelles (oui, aussi un peu les rumeurs, ajouta-t-elle malicieusement). Je cuisine et mange ce que j’aime. La cuisson est celle qui convient à mon intestin, j’ai toujours été fragile de ce côté-là. Je ne veux pas à être prisonnière dans un bâtiment fermé à clef, dans une petite chambre. Je ne veux pas marcher au pas, manger à 18 heures, attendre, toujours attendre, les heures de repas, d’activités, de passage des soignants, zut, ma liberté avant tout, et tant pis si je casse ma pipe dans l’escalier. Allez, au revoir, petit, passe quand tu veux.
Extrait 3 – Recherches : rue des Barrys et Jean
La rue des Barrys était calme. Des maisons de trois niveaux en pierres aucun bruit ne sortait, pas de radio, pas de télé, aucun cri d’enfant. Pourtant, les habitations étaient mitoyennes des deux côtés, les motifs de dispute évidents- poubelles, voitures en stationnement interdit, linge étendu aux fenêtres, courrier reçu par erreur, crottes de chiens, chats errants etc. Rien. Pas tout à fait. Quelques mots gentils étaient échangés d’une fenêtre à l’autre. Les informations du jour circulaient, cabas posés à terre : « Comment va la petite? Et la grand-mère? Moi, ça va, à part les satanés rhumatismes. » On s’asseyait sur les marches devant les maisons lorsqu’on avait besoin de plus de temps pour s’épancher, « ah, la vie n’est pas un long fleuve tranquille, non, tu sais pas la dernière? » On saluait Gérard d’un air soupçonneux. Il hochait la tête sans oser poser la moindre
question. Jean vivait dehors, il n’était jamais malade, Gérard allait bien finir par le croiser.
Dans la rue principale, pavée elle aussi, des gens entraient et sortaient de l’épicerie « Chez Téolin », du magasin de fleurs ou de chez l’opticien, mais c’est à la boulangerie de la Tour qu’il y avait le plus d’affluence, son pain était réputé. Toujours pas trace de Jean. Gérard ne portait pas de montre, la course du soleil le guidait. Il devait rejoindre son poste à 11h30. Il leva la tête pour admirer la tour construite en pierres claires et aperçut une horloge qui le rassura, il n’était que 10h. Quel rôle avait pu jouer cette tour jadis? Gérard n’en savait rien. Il lui suffirait d’orienter la conversation sur le sujet, Jean dirait tout ce qu’il savait, il était imbattable en histoire locale.
Sa curiosité finit par intriguer les ménagères affairées. Son oisiveté aussi. Elles faisaient leurs courses telles les fourmis convoyant graines et brins de paille plus gros qu’elles dans la fourmilière; elles se pressaient à petits pas de la boucherie située face à la mairie jusqu’à l’une des deux boulangeries ou à l’épicerie, ces dames avaient une haute idée de leur importance, leurs familles comptaient sur elles pour préparer le déjeuner, elles s’affairaient dignement, comparaient, choisissaient, comptaient la monnaie, savouraient les attentions des commerçants, qu’aucun ne s’avise à leur manquer sinon la sanction tomberait, elles boycotteraient son commerce sans barguigner. Que diable, le «bonjour Madame Renée, vous allez bien ce matin?» était la reconnaissance qu’elles venaient chercher, pas seulement des pommes et du fromage, du jambon et quatre tranches de rumsteack.
Que fout ce type, les bras ballants, il baille aux corneilles ou quoi? Qu’est-ce qu’il a à regarder la tour? Il l’a jamais vue, ma parole? C’est pas la place des bonshommes d’empiéter sur notre territoire, du balai! Il n’a qu’à rejoindre les autres, ils refont le monde, bien assis sur la pierre lisse, le dos calé contre le mur réchauffé par le soleil, celui de la salle des Rencontres la bien-nommée.
Ceux dont elle parlait constituaient le premier groupe. Exclusivement des pépés tranquilles, moustaches au vent, béret sur la tête, zieutant tout ce qui portait jupons sans avoir l’air de rien, absorbés qu’ils faisaient semblants d’être par des théories que décrivaient leurs bras moulinant de droite à gauche ou de haut en bas selon l’inspiration du moment. Le second groupe était moins homogène. Il comprenait des oisifs plus jeunes- chômeurs de longue durée, handicapés, malades, étudiants n’étudiant pas- et des étrangers au territoire, cyclistes ou motards en groupe, visiteurs retraités voyageant hors saison, seuls, à deux ou en circuit organisé. Ces derniers étaient les plus bavards. Ils échangeaient des plaisanteries qui les faisaient s’esclaffer, c’était à croire qu’ils avaient choisi ce mode de vacances pour sortir de leur isolement à 2, se sentir rajeunir et vivre comme avant, le service tout compris avait bien des avantages, pas de course ni de cuisine, fini le ménage et le lit à faire, être servi du matin au soir libérait leurs énergies, l’insouciance revenait, ils riaient pour un rien, ils faisaient rire, ils existaient. Les ménagères Saint-martinoises les enviaient, « à quand notre tour? », semblaient-elles demander. Il y avait aussi les habitués du comptoir, des poivrots absorbés dans les pensées que l’alcool leur infusait. Ceux-là se taisaient le plus souvent. L’œil torve et la face rougeaude, ils faisaient semblant de suivre un match de foot à la télé, haut perchés sur les tabourets, la tête soutenue par un bras plié.
Extrait 4 – Traditions méditerranéennes
« Il remonta la rue du torrent de Toulouze, affrontant avec plaisir une pente raide, rare dans ce pays plat. À mi-chemin, sur la droite, partait la rue des Barrys Haut. Gérard ignorait ce que pouvaient être les Barrys mais ils avaient marqué les esprits, il y avait deux rues du Barrys à Saint Martin de Londres. Il avait appris récemment que Jean habitait au numéro 5. Gérard ne l’avait pas vu au bar, Jean devait être chez lui, il frappa. Il entendit des pas hésitants se rapprocher de la porte. Une clef
tourna dans la serrure. C’était bien Jean. Ou quelqu’un de sa famille. car son apparence était différente de celle qu’il montrait d’ordinaire. Cet homme était emmitouflé dans une robe de chambre de couleur grenat. Sa face aussi était rouge, violacée, sombre. Les traits tirés, Jean, car
c’était bien lui, avoua qu’il était malade.
Le docteur est venu?
Pas besoin de docteur, j’ai du thym.
Ah bon!
Gérard avait récemment découvert cette tradition que les vieux Méditerranéens respectaient à la lettre. Il suffisait selon eux de se baisser en garrigue pour cueillir la plante miracle, elle guérissait de tout. Ses branches sont riches en huiles essentielles, tout le monde le dit. Il soulage rhumes, toux, bronchites. Il calme les inflammations de la gorge. L’état dans lequel Gérard trouva Jean allait nécessiter des tonneaux de tisane, il n’était pas flambard.
– Tiens, je vais en faire bouillir, tu en veux?
Gérard avait-il le choix? Il acquiesça pour l’accompagner.
– Ça te fera du bien. Le thym prévient aussi ces saletés de maladies hivernales.
Extrait 5 – Une tombe dans le paysage
Entre le Pic et la forêt qui s’étend entre Saint Martin de Londres et Viols en Laval, Gérard trouva une route. Elle était d’ordinaire peu fréquentée; le jour où il la traversa à 17h30, pressé de rejoindre son poste de travail après l’escapade bucolique qui l’avait conduit au-dessus du Mas de Londres, le flot de voitures s’étirait, les salariés rentraient de Montpellier pour rejoindre leurs pénates de plus en plus loin de la ville- cherté des terrains oblige, désir d’avoir son lopin de terre, étalement urbain. Gérard avait lu une pancarte curieuse : « Col de la Pourcaresse ». Lui qui avait traversé la Vanoise et grimpé les cols des Alpes Grées, il en riait intérieurement. Sans rien montrer : les gens d’ici sont susceptibles, c’est chez eux, quoi! Ce qui est vrai, Gérard s’en aperçut en longeant la route vers Saint Martin de Londres, c’est que la vue sur le village était belle.
Cette route était une barrière aux yeux de Gérard. Il n’osait pas la franchir. Peut-être avait-il trop « fait la route » justement pour redescendre des Alpes, peut-être avait-il intériorisé une peur des dangers que la route faisait courir, pas seulement le risque de collision, celui- vital- d’être poursuivi, pourchassé, traqué, il suffisait aux mafieux de conduire, d’appuyer sur l’accélérateur, de prévoir un plein d’essence, de suivre l’itinéraire du fuyard…pour, tôt ou tard, lui mettre la main dessus, une main de fer, Gérard Asseraf était bien placé pour le savoir. En montagne, les forêts étaient autant de cachettes. Les amas rocheux, des abris sûrs. Au premier signe anormal Gérard était capable de grimper une côte escarpée, de zigzaguer dans la végétation sans casser de branche, sans fouler de fougère et il se sauvait. Ici aussi, le terrain était accidenté. Depuis Viols en Laval serpentait un sentier de caillasses qui tournait et virait, plongeait vers un ruisseau cent mètres en contrebas, le traversait sur des rochers instables, montait ensuite avant de reprendre sa course à travers champs, une course jamais rectiligne, sur une pente rien moins que douce, avant d’atteindre le mas de Vitrolles et Saint Martin de Londres.
Un après-midi pluvieux d’automne pourtant, Gérard s’enhardit et traversa la chaussée presqu’en courant bien qu’aucun véhicule ne soit en vue. Il continua à courir sur une étroite départementale en direction du Mas de Londres- sa trouille des routes, toujours. À gauche, le mas de la Pourcaresse était fléché. Il s’écarta de la route et coupa à travers des clairières puis une forêt clairsemée. De-ci, de-là, quelques chênes centenaires devaient ombrager les promeneurs égarés, l’été. Le froid piquant de ce début novembre n’avait pas empêché un quidam d’installer son chevalet à cet endroit. Il avait dû venir à pied, aucune voiture ne stationnait à proximité, à moins qu’il n’ait été déposé là par un parent ou un ami. C’était un homme dont la petite taille faisait ressortir l’embonpoint. Il portait des vêtements quelconques qui dépassaient par un côté d’un imperméable marron passe-partout. Gérard remarqua surtout ses chaussures de marche. De longues randonnées lui avaient enseigné l’importance des chaussures, elles disaient tout des interlocuteurs. Aussi visait-il leurs chaussures immédiatement après les avoir salués. Gérard se doutait que ces inconnus jugeaient son attitude hypocrite comme tout ce que faisaient les gens de sa race, peu importait. Ses chaussures étaient boueuses, ce détail rendait le type sympathique, pas au point tout de même de s’approcher de lui, la vie avait appris à Gérard la méfiance. Après un hochement de tête aussi sobre de part et d’autre, il continua sa promenade sans but. Elle le conduisit au sommet d’une falaise sans gravir quelque montagne que ce soit, simplement le territoire était accidenté, au bout de ce qui devait être un long plateau calcaire il dégringolait dans le vide. Le panorama s’étendait loin, il y avait un village en bas à gauche, sans doute un de ceux finissant par « de Londres »; pas Saint Martin, non, Saint Martin se trouvait au bout de la route traversée tout à l’heure; plutôt le Mas. Sur la colline, Gérard aperçut des maisons en pierres; plus bas, dans la plaine, une succession monotone de parpaings recouverts de peinture, sans originalité aucune. En arrière fond du tableau, de petits monticules. À droite, les deux compères, Hortus et Pic Saint Loup. Un sentier conduisait vers ces montagnes, elles aimantaient Gérard. Il était étroit, c’était l’idéal pour lui. Les pistachiers s’inclinaient de part et d’autre, ils formaient une arche magique. Le sentier n’était pas rectiligne, raison de plus pour le suivre. Au bout d’un kilomètre environ, il grimpait. Des pierres, des racines, des glands, des branches mortes l’encombraient. Gérard se sentait toujours bien quand il marchait. La marche lui procurait une agréable paix intérieure. Pourquoi s’arrêta-t-il brusquement en pleine côte? Peut être à cause des fleurs séchées qu’il aperçut sur le côté du droit du chemin. Il se pencha, intrigué. Elles étaient déposées aux pieds d’une stèle en pierre grise lisse. Gérard déchiffra à grand peine l’inscription en partie effacée :
Ci git François Collet,
De Roubiac,
Décédé subitement ici le 28 juin 1881,
À l’âge de 61 ans.
Passants, priez pour lui.
Ce pauvre homme était mort loin de chez lui. Roubiac est un hameau planté à l’écart de la petite route en lacets qui part de l’autre côté du Pic Saint Loup, de Cazevieille exactement, c’est pas la porte à côté à pied, Gérard évaluait la distance à quinze bons kilomètres. Que faisait au dessus du Mas de Londres ce marcheur de soixante et un ans? Était-il berger?