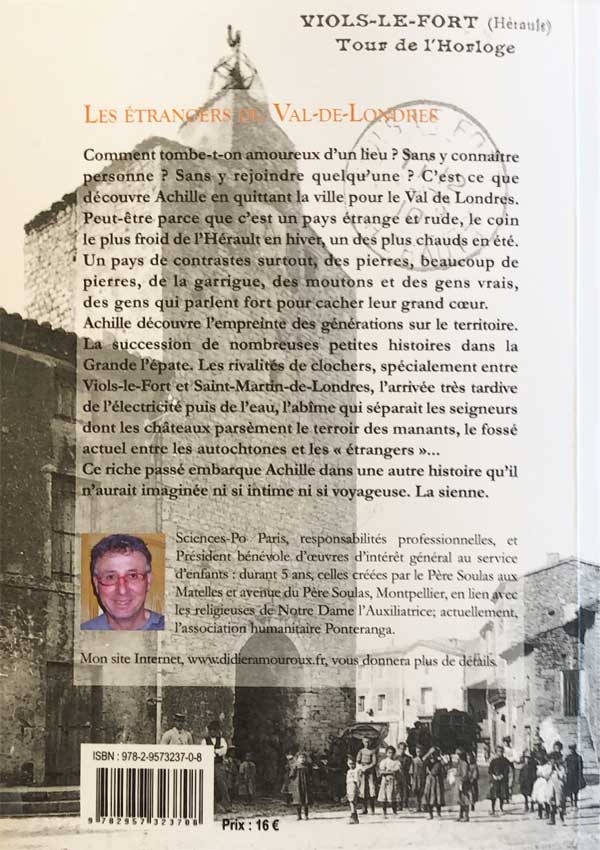LES ETRANGERS DU VAL-DE-LONDRES
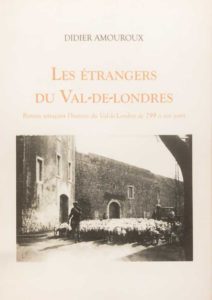
→ Roman de Didier AMOUROUX – parution 2020
Présentation du roman
HISTOIRE DE SAINT MARTIN DE LONDRES, NOTRE DAME ET MAS DE LONDRES, VIOLS EN LAVAL, VIOLS LE FORT, CAUSSE DE LA SELLE, SAINT JEAN DE BUEGES, GANGES, PUECHABON, ANIANE, SAINT MATHIEU DE TREVIERS, LES MATELLES, COMBAILLAUX, SAINT GELY DU FESC
DE 799 À 2025,
CAR, EN PLUS DE L’HISTOIRE DU PAYS DU VAL DE LONDRES, CE LIVRE EST UN ROMAN.
Comment tombe-t-on amoureux d’un lieu? Sans y connaître personne? Sans y rejoindre quelqu’une? C’est ce que découvre Achille en quittant la ville pour le Val de Londres. Peut-être parce que c’est un pays étrange et rude, le coin le plus froid de l’Hérault en hiver, un des plus chauds en été. Un pays de contrastes surtout, des pierres, beaucoup de pierres, de la garrigue, des moutons et des gens vrais, des gens qui parlent fort pour cacher leur grand cœur.
Achille découvre l’empreinte des générations sur le territoire. La succession de nombreuses petites histoires dans la Grande l’épate. Les rivalités de clochers- spécialement entre Viols le Fort et Saint Martin de Londres, l’arrivée très tardive de l’électricité puis de l’eau, l’abîme qui séparait les seigneurs dont les châteaux parsèment le terroir des manants, le fossé actuel entre les autochtones et les « étrangers »…
Ce riche passé embarque Achille dans une autre histoire qu’il n’aurait imaginée ni si intime ni si voyageuse. La sienne.
PARTIE 1 – Premières découvertes (page 19)
de 799 à 1620
J’ai commencé par abattre les planchers des combles. Les débris du parquet en bois usagé n’ont pas été les seuls à tomber. Des informations planquées depuis des siècles ont été exhumées de leur cachette poussiéreuse. Une fois retournées, les planches ont livré de drôles de secrets. Ou plutôt une partie de plusieurs secrets, il va me falloir les relier les uns aux autres pour reconstituer ce puzzle aux morceaux éparpillés, oubliés, abandonnés.
Je lis, gravée dans le bois cette inscription :
« Ma descendance,
Des religions, des riches et des puissants, tu te méfieras. »
Elle est signée Louis, prénom banal.
La date l’est moins : 1620.
Louis était adroit de ses mains; il ne déclare pas sa profession; menuisier peut-être? Il ne déclare rien, d’ailleurs. Il se cache pour écrire, il le fait au dos des planches de son parquet, elles mêmes cloutées à d’autres planches pour que le visiteur ou la Police de l’époque ne voit rien en levant la tête.
J’ai du mal à déchiffrer la suite. Il faudrait plus de lumière, la pièce est sombre. Je sors au grand jour, personne ne passe dans cette rue étroite. Tiens, voilà que je me prends au jeu, quelle importance que ce texte soit lu par d’autres, il y a prescription depuis quatre cent ans, non? D’ailleurs, la suite est incompréhensible :
« Les Seigneurs, tous des voleurs.
1562 Combajalgues détruit par les protestants.
1584 Antoine de Cambous, catholique assassin.
1602 Je tue Guittard de Ratte, le grand Inquisiteur.
1619 Je rate de peu Jeanne de Roquefeuil. »
Louis prend des risques, il avoue ses crimes, un Inquisiteur et une noble richissime à son tableau de chasse, ce n’est pas rien pour un roturier de la plus basse espèce. Non, je me trompe, il ne les avoue pas, il transmet un message à ses descendants :
« Des religions, des riches et des puissants, tu te méfieras. »
Que s’est-il passé?
Et d’abord, Combajalgues, que désigne ce curieux nom? La curiosité facilite les recherches, je demande autour de moi.
Personne n’en sait rien.
Pour que Combajalgues ait été détruit, il fallait pourtant bien qu’il existât aurait-on écrit alors. Mais les vieux du coin ne trouvent pas Combajalgues dans leur mémoire. Rien de ce qui s’est passé entre 1930 et 2018 ne leur a échappé, « mais 1562, avouez, jeune homme, c’est un peu ancien, non? Allez donc aux Archives. »
Je vais moins loin. Je tape « Combajalgues » sur Internet.
Deux réponses : 1) Abbaye d’Aniane; 2) Mas de Cournon.
Le Mas, je le connais, il se trouve sur la route de Puéchabon, quelques kilomètres après la sortie de Viols le Fort. Il ne faut pas plus de cinq minutes pour y arriver. Aucun problème pour stationner, pas de créneau à faire, pas un chat. Cette fois, j’aurais préféré rencontrer quelqu’un. Je vais jusqu’au Mas. Il est devenu un hôtel restaurant. Ses propriétaires ne connaissent pas l’histoire de leur bâtisse.
– 1562? Vous vous rendez compte?
Seul le commerce compte pour eux; tout ce qu’ils ont à faire pour qu’il rapporte les mobilise : décorer, s’approvisionner, cuisiner, entretenir, facturer, nettoyer…
Un peu plus loin, un immense domaine ceint de grillage. Interdiction de pénétrer. Au loin, j’aperçois une vieille église.
L’enquête sur place ne donne rien de plus, sus aux Archives.
Elles sont bien tenues, simplement les références font des ricochets d’un texte à l’autre.
Le premier est encore plus vieux. Il date de juin 799. C’est une donation du Roi des Francs et des Lombards, Charles- ce devait être le premier ou un des premiers, il ne croit pas utile de préciser son matricule- au « vénérable abbé Benoit, du Monastère d’Aniane, situé dans le pays de Maguelone ». C’est un peu fort, je trouve, Maguelone est située au bord de la mer, c’est à dire à au moins une heure de route de Viols le Fort. Une heure en voiture aujourd’hui devait en valoir trois ou quatre en 799. Passons, j’apprendrai plus tard que l’évêque de Maguelone était propriétaire d’à peu près tout dans le département. Tout, pas tout à fait. Il lui manquait Combajalgues. Et c’était quoi, Combajalgues en 799? Pas une église, non, juste des « bâtiments destinés à abriter le gros bétail et les troupeaux qui paissent dans les pâturages », précise le donateur. Finalement, les moines ne s’intéressaient pas seulement aux lieux de culte; ils ne crachaient pas sur les biens matériels, les animaux d’élevage, le produit des cultures…
Les barons locaux également. A cheval, ceux-là galopaient à travers champs, entourés de leurs troupes, et s’emparaient des bêtes peu gardées. Aniane se trouve à dix bons kilomètres, les barons étaient chez eux et entendaient s’approprier les richesses, toutes les richesses, l’évêque était trop loin pour les en empêcher, c’est ce qu’ils pensaient.
Il avaient tort, en principe.
Le 22 juin 852, Charles le Chauve confirma cette dotation à l’abbé Arnoulf. Cela ne semble pas avoir suffi, les nobles continuèrent leurs rapines, le nombre de bêtes fondit à vue d’oeil. Les abbés d’Aniane avaient des relations, ils s’adressèrent directement au Pape. J’en apprends de belles, ce Pape s’appelait Anastase; il signa une bulle.
Il me faut un temps de réflexion pour me souvenir qu’une bulle, c’était son ordonnance à lui. Elle disait quoi, sa bulle du 17 novembre 1154? Qu’il prenait sous sa protection toutes les possessions du monastère, la liste était longue : il y avait bien sûr l’église Saint Etienne de Viols le Fort mais aussi toutes les chapelles de cette église, dont…Combajalgues. Ah ah, voici enfin Combajalgues! Oui, mais le pape résidait très loin d’Aniane contrairement aux nobles de Puéchabon, de Cambous, de Cournon de Combajalgues; ni vu ni connu ils continuèrent à exploiter le bétail à leur façon, ils se l’approprièrent. Le pape suivant put bien buller à son tour en 1155, les barons s’en moquaient. Peu leur importait que, trente ans plus tard, l’abbaye d’Aniane achète les droits que possédait Bertrand de Puéchabon sur le terroir de Combajalgues, et au prix fort encore, quatre cents sous melgoriens j’ignorais jusqu’à l’existence de cette monnaie. Les Seigneurs continuaient leurs exactions, volaient le bétail, chassaient, s’emparaient des cultures et des dîmes versées par les quatre-vingt cinq habitants de Combajalgues. Les Protestants mettent tout le monde d’accord en 1562. Leur place forte était Clermont l’Hérault. Catholiques et Protestants s’en emparaient à tour de rôle, le duc de Joyeuse en 1562, Danville en 1577, c’est ce que m’apprennent les archives. Et aussi que l’empreinte protestante était si forte sur cette ville que l’édit de Nantes l’offrira aux Protestants comme place de sûreté. A l’époque dont je parle, c’était le tour des Protestants. Clermont l’ Hérault ne leur suffisait pas. Ils grimpèrent jusqu’au plateau, direction le château de Montferrand, sur la colline qui domine l’actuel Saint Mathieu de Trèviers. Sur leur route ils trouvèrent quoi? Calages et Combajalgues. Avant de détruire Calages qui était pourtant une ferme fortifiée, elle appartenait au Seigneur de Cambous, ils se firent la main sur Combajalgues; ils dévastèrent tout et d’abord l’abside du sanctuaire, les murs de la nef, la maison curiale; cela ne suffit pas, ils emportèrent la cloche; les survivants ne purent alerter personne; Calages n’entendit pas les Protestants arriver.
Je suis content de moi, les deux premières inscriptions sont élucidées. Louis était bien informé, aurait-il vécu à Combajalgues? Se serait-il enfui à pied à travers bois en évitant les chemins? Accessoirement en raison de leur mauvais état. Principalement pour les mauvaises fréquentations que le paysan risquait d’y faire, les troupes des Seigneurs l’auraient transpercé, ils étaient les seuls à être armés et n’hésitaient pas à tirer l’épée. Aurait-il coordonné une forme de révolte paysanne? Je finirai par le savoir, je suis sûr que la maison crachera le morceau.
Antoine de Cambous est nommément désigné sur la troisième inscription. Ce n’est pas par hasard. Une poutre vermoulue recèle d’autres caractères minuscules, je dois aller chercher ma loupe pour les déchiffrer. Ce que je lis m’effraie : Antoine ne faisait pas de quartier; au moindre doute sur la pratique religieuse d’un manant, à la moindre parole contrevenant aux évangiles- qu’elle soit rapportée, déformée, amplifiée-, il trucidait sans pitié, sans manières, sans procès, Antoine de Cambous avait tous les droits, il était Seigneur sur ses terres. Grand, musclé, le regard fier et méprisant, il toisait les paysans du haut de sa monture. Il était un ferme soutien du Pape, de l’Evêque, du Roi contre les hérétiques. Il trépignait au début des guerres de religion, comment prouver mieux son courage qu’en faisant régner la terreur? Montrer sa bravoure lui importait autant que de propager la religion catholique. Une belle occasion se présenta à lui en 1574. Le seigneur de Cambous, qui avait hérité d’une modeste ferme à peine dotée d’une tour, bouillait d’impatience lorsqu’il apprit que les Protestants avaient pris d’assaut le superbe château de Montferrand, juste de l’autre côté du Pic Saint Loup. Sa colère était légitime : le mauvais choix religieux du comte de Toulouse (qui en était le propriétaire initial) avait été sanctionné : le Pape l’avait dépossédé de cette forteresse et l’avait attribuée à l’évêque de Maguelone, encore lui. Antoine de Cambous leva une troupe. Avec quels moyens je l’ignore, il paraissait désargenté jusqu’ici. Le Roi de France l’aurait-il financé? Il s’empara du château en 1584. Ce fait d’armes lui valut les félicitations du Roi. En paroles ce qui était beaucoup d’honneur à ses yeux d’aristocrate; en titre de propriété, il lui octroya le fief de Montferrand; en tombereau d’espèces sonnantes et trébuchantes, voilà ce dont il avait le plus besoin pour transformer sa citrouille en carrosse, sa ferme en château. Cambous ressortit triomphant des guerres de religion, couvert de gloire, de terres, d’argent et doté d’un vrai château, avec créneaux et tours et salle de bal…
Le château fort, je le vois se détacher sur la plate garrigue lorsque je reviens d’une balade sur le Patus, la montagne qui grimpe à cinq cents mètres au dessus du château d’eau. Je ne m‘y risque pas aux heures chaudes, uniquement le matin; la côte est rude pour atteindre le point culminant d’où l’on voit la mer, le Pic St Loup, l’Hortus qui lui fait face, le village et…le château. De là-haut, les paysages du nord de l’Hérault se révèlent à moi : la rivière Hérault, encaissée entre des rochers blancs, serpente et arrose le village médiéval de Saint Guilhem le Désert; sur le mont qui le domine, les pentes couvertes de romarin, de ciste, de bruyère calcaire, de thym précédent la forêt clairsemée des Lavagnes. Avant d’arriver à ce point de vue, sur la gauche, j’aperçois Combajalgues, aujourd’hui dénommé Cournon du nom de la famille propriétaire dont les générations successives se sont fait appeler Cournon de Combajalgues puis, Combajalgues ayant disparu, Cournon tout simplement.
C’est au retour surtout que j’admire le château. Ses tours crénelées se détachent sur la plaine nue.
Louis m’apprend qu’Antoine de Cambous n’utilisait pas sa force exclusivement pour combattre. Je relève l’adjectif « fort » qu’il utilise sur ses morceaux de bois pour le qualifier. Le gaillard avait d’autres besoins, qu’il satisfaisait dans le cercle fermé de la noblesse languedocienne (là, je sens que Louis persifle, il n’en sait rien, il crache son venin) et sur ses terres, il tuait les hommes, violait les femmes, Louis les énumère toutes, celles du village, celles de Combajalgues, Maure, Prax, Lavit, Andrieu, mas éloignés que le Seigneur et Maître parcourait à cheval en soupesant du regard la taille des ovins, la fertilité des terres cultivables et…la croupe des femmes. Elles s’enfuyaient à son approche. Il s’en réjouissait, partait d’un rire carnassier et lançait son cheval et ses chiens à leurs trousses. Louis ne le dit pas, mais, ne serait-ce pas là l’étymologie du nom « Viols le Fort »? Il y a un hic à ce raisonnement je le sais, c’est que le village s’appelait ainsi avant qu’Antoine de Cambous ne sévisse. Mais il avait des ancêtres que diable, et ils n’étaient pas moins brutaux que lui, les échanges épistolaires des moines de l’abbaye d’Aniane à propos de leurs exactions en donnent une idée.
Les viols qu’il enchaînait sans état d’âme lui valurent d’être puni par où il avait péché. Attrapa-t-il la syphillis ou une saloperie du même genre? Toujours est-il qu’il n’eut pas d’enfant. Louis a dû s’en réjouir, je le suppose en lisant les lettres moins bien gravées que son poinçon a formé à grande vitesse, comme s’il était pressé de témoigner de cette sanction.
Un noble sans descendance! Le héros de la prise de Montferrand, le vaillant officier, l’architecte de la transformation du château de Cambous n’eut pas d’enfant auquel le transmettre avec son titre et sa gloire et ses armes.
Sa stérilité ne le rendit pas humble devant les hommes. Devant Dieu, nul ne le sait, je ne me fie pas aux apparences, à ses discours enflammés de sauveur de la foi catholique, à ses coups de lance et d’épée. De retour au château, il continuait à assouvir ses instincts, cette fois au nom de sa religion. C’était un catholique intransigeant, Antoine de Cambous. Le siège de l’inquisition épiscopale ne fut pas implanté dans son château par hasard; les sous-sols furent rapidement étrennés, des salles de torture installées et des tortures pratiquées jusqu’à aveux complets, récompensés par une mort brutale. Je comprends mieux l’inscription gravée par Louis :
« 1584, Antoine de Cambous, catholique assassin. »
Pas la suivante : « Je tue Guitard de Ratte, le grand Inquisiteur ».
Plusieurs familles sont implantées dans le village depuis des générations : les Avinens, les Claparède, les Caizergues, les Olivier, les Vialla, les Challier, les Coste, les Durand, j’en passe, ne les connaissant pas toutes; je vais leur demander qui était ce Guitard de Ratte? Parmi ces amoureux du coin, je trouverai bien un passionné d’Histoire.
Le contact n’est pas facile de prime abord, je suis un étranger, un nouvel arrivant. Eux sont des héritiers de Violiens depuis des siècles. J’admire cet enracinement;mes ascendants viennent d’un peu partout, c’est d’ailleurs la première question que mes interlocuteurs me posent : « d’où êtes-vous? » Eux savent très bien d’où ils viennent. De Viols le Fort, point. Leurs pères travaillaient la terre; plus tard ils m’expliqueront les champs de céréales disséminés dans des fonds de vallée moins infertiles que les autres, loin du village; l’exploitation des ovins et du bois. Pour l’instant, c’est à moi de montrer patte blanche, d’où ma famille est-elle originaire? Bonne question. Elle vient de partout ma famille, de Lozère surtout mais aussi de l’Est Héraultais, il y a même des arrières-grands-parents descendus de Paris; je gomme immédiatement Paris de mon arbre généalogique; trop loin, trop urbain, une image de préciosité colle à la capitale; c’est peu dire que mes interlocuteurs sont des terriens, les bruits et prétentions de la ville les insupportent. Ma réponse tronquée doit les rassurer, le fait aussi que je choisisse d’habiter entre les murailles du vieux village et pas dans l’une des villas construites à la périphérie, sans âme sans originalité, cachées par de hauts murs ou des haies d’arbustes; l‘admiration qu’ils sentent poindre en moi pour la fidélité des leurs à leur terre nourricière, à leurs racines, pour la constance de leurs choix alors même que les activités économiques assuraient à peine leur survie. Je ne mettrai pas leur modestie en péril en citant les noms complets des protagonistes de l’histoire qui va suivre, l’initiale des noms de famille suffira, surtout que plusieurs commencent par la même lettre : C; chacun la prendra pour sienne.
PARTIE 1 – Premières découvertes (page 37)
de 2000 à 2018
Plusieurs m’orientent vers Germaine, elle habite juste avant la Tour du Fabregol. C’est à deux pas. Un passage de la Place du village vers le Fort a été percé entre les piliers de la Tour sous une voute haute. En regardant l’heure tout en haut de l’édifice, j’ai lu la pancarte :
« Tour du Fabregol,
1420 »
Des ronchons m’ont déjà mis en garde. « Fabregol » n’est pas son vrai nom, ça ne veut rien dire « Fabregol ». Le nom exact est « Fanabregol », rouspète le vieil André qui n’articule rien, je dois tendre l’oreille pour percevoir des bribes de mots qui s’échappent difficilement de sa bouche édentée, un filet de voix traverse sa barbe, épaisse à quelque heure du jour que je le croise.
– Oui « Fanabregol », vous connaissez notre langue, jeune homme?
– Ben oui, je parle français. Avec tout le temps que j’ai passé sur les bancs de l’école, le contraire serait malheureux!
– Il s’agit bien du français, pecaïre!
J’ai réussi à mettre André en colère. Cette fois, la barbe drue n’a pas retenu ses mots, ils sont sortis avec toute la force de son indignation. « Pecaïre », le pauvre, m’a-t-il appelé. Pas pauvre en argent, il s’en fout de l’argent, André; à son âge il ne l’emportera pas où il ira, au Paradis on a tout ce qu’il faut sans bourse délier, André est un pilier de l’église. A ses yeux, je ne suis qu’un pauvre illettré qui ne connait pas la langue de sa terre, celle de ses ancêtres- l’occitan se parlait aussi en Lozère ou dans l’est de l’Hérault, il a retenu que ma famille vient de là-bas, loin de son centre de gravité, Viols le Fort.
– L’occitan, Achille!
Sa colère est tombée, il retrouve mon prénom, il veut expliquer, transmettre lui aussi, comme Louis, mais oralement :
– Fanabregol est le nom occitan de micocoulier.
Je connais cet arbre au tronc gris-blanc. Il pousse spontanément, quelque soit le sol, n’importe où, les pierres ne le gênent pas. Ses feuilles vertes sont caduques.
– En plus de ses racines solides qui s’étalent partout, ce saligot déverse des tonnes de feuilles qui viennent joncher le sol et boucher les canalisations. Il nous donne bien du travail, tiens! Si on néglige de le faire (quand je dis « on », je pense aux cantonniers; moi, j’ai assez de mal à tenir debout en m’appuyant sur ma canne), les orages cévenols ne s’évacuent pas, l’eau s’accumule et les portes d’entrée au rez-de-chaussée ne l’empêchent pas d’inonder les habitations, tu sais?
– Non, je ne sais pas.
Je m’aperçois depuis que j’habite à Viols le Fort qu’en dépit de mes études, dites supérieures, je ne sais rien des choses essentielles liées à la terre, aux éléments, bref à la vie. Ma tête qui balance d’un côté à l’autre est un signe de dénégation qu’André comprend au quart de tour, mieux que des paroles, il est malentendant. Croit-il que je sois aussi sourd que lui?, il se répète.
– Je te dis que micocoulier se dit « fanabregol » en occitan.
Cette fois, je varie mon expression, je hoche la tête comme un homme pénétré par une révélation inattendue. Sauf que je ne vois pas le lien que pourrait avoir un micocoulier avec une tour édifiée en 1420! D’ailleurs, il n’y a pas l’ombre d’un micocoulier sur la place du village, je ne suis pas miraud!
– Eh oui, ajoute-t-il comme si c’était évident, un micocoulier géant s’élevait face à la tour de l’horloge. Ce satané arbre a bien des défauts, il repousse toujours de l’endroit où tu l’as coupé j’avais oublié de te le dire. Pas celui-là, ils l’ont déssouché avec une grue, dommage, il nous procurait une ombre bien agréable.
Serait-il audois ou haut-pyrénéen, la question se pose tant il roule les r. Je n’ose l’envisager. Il est enraciné dans cette terre dure, justement comme un micocoulier humain. André complète mon éducation violienne sur un ton lugubre :
– La tornade du 22 février 2000 l’a abattu, dis donc!
André se tait. Il pense à cet évènement mémorable dans la vie villageoise, la tornade de 2000. Son visage est devenu grave; ses yeux, d’ordinaire rieurs, sont assombris. Je n’ose pas interrompre ses rêveries, je n’ai pas bien compris le lien qu’il pourrait y avoir entre un micocoulier et une tour de vingt mètres. La hauteur, peut-être?
– Fanabregol est le nom occitan de micocoulier.
A force de le répéter, il me fait entrer cette information dans le crâne! Sauf que :
– André, sur la pancarte, il y a écrit « Fabregol », pas « Fanabregol ».
– Eh oui, je me tue à te l’expliquer. Cet imbécile de graveur a oublié une syllabe : « na ». Quand il a livré son travail, le Maire n’a pas eu le coeur de le lui faire refaire, c’était trop tard a-t-il jugé. Il a eu tort. On finit par ne plus rien comprendre aux choses quand on mélange tout, je t’en foutrais des « fabregol », moi!
Germaine donc. Elle habite à l’intérieur du Fort, la première maison sur la droite en venant du centre. Sa maison ressemble à toutes les autres, celles qui tiennent debout; la mienne les imitera une fois que je l’aurais retapée. C’est à dire qu’elle a trois niveaux. Pas commode pour une septuagénaire, je me mets à sa place. Pour accéder au premier, il faut gravir dix marches en pierres grises sans rampe aucune; ce doit être pareil à l’intérieur. Je me trompe à peine. Germaine a condamné l’étage supérieur. Elle vit dans les deux du bas. Au rez-de-chaussée surélevé se trouve sa machine à laver, elle est moderne Germaine, sa volaille, ses lapins, le bois de chauffage. Entre le rez-de-chaussée et l’étage intermédiaire, il n’y a que sept ou huit marches à monter, je ne les ai pas comptées. Là se trouvent la cuisine, pièce essentielle où se déroule toute sa vie, une chambre, les WC et une petite salle d’eau éclairée par un vasistas ridicule qui donne sur l’arrière.
Germaine me propose de loger au dernier étage. C’était le grenier jadis. Ses parents y stockaient les pommes de terre, les oignons, l’huile dans des jarres (ils avaient des oliviers dans le temps), le foin et la paille du bétail surtout.
J’ai du mal à me projeter dans ce passé qui lui est cher. Les murs sont peints en blanc. Une fenêtre haute laisse entrer le jour; le soleil, ne rêvons pas, entre les murailles du Fort il ne pénètre que très exceptionnellement lorsqu’il est au zénith, en plein été. Son âge avancé n’a rien enlevé aux facultés cognitives de Germaine, elle perçoit mon incrédulité.
– Oui, petit- tiens, je suis son petit, mot affectueux qui vient éponger mon chagrin comme une éponge l’eau, ou plutôt comme une compresse une brûlure, mon coeur est irradié, cela ne se voit pas, comment le sait-elle?
– Cette fenêtre (elle me la désigne de la main gauche, la droite tient un seau qu’elle remplira de pommes de terre, elle économise ses montées et descentes, son dos aussi), on l’appelait « la portalhiera ».
– J’ai lu « portalière » quelque part.
– C’est le nom français. « Portalhiera », c’est plus joli.
Elle ne demande pas, elle affirme.
– La « portalhiera » était surmontée d’une poulie, je l’ai conservée, penche-toi, la vois tu?
– Oui.
– Sais-tu à quoi elle servait?
– A hisser des choses.
– Lesquelles?
Je donne ma langue au chat, son gentil « mon petit » me renvoie, sans que je fournisse aucun effort de mémoire, à mes jeux d’enfant, je régresse délicieusement.
– Des ballots de foin et de paille, des fagots de muriers dont se nourrissaient les lapins, l’hiver, quand l’herbe était rare.
Voilà mon nouveau logement. Peu m’importe de passer par la cuisine pour y accéder, je serai à deux pas de chez moi, moins seul le soir aussi.
En sortant, l’anneau en fer qui servait à attacher cheval ou âne attire mon attention. Je crois aux signes, cet objet rouillé me portera bonheur comme le trèfle à quatre feuilles ou le fer à cheval, tout est dans la tête.
PARTIE 3 – Changements (page 158)
de 1840 à 1857
– Mon père, me dit-il en ancrant ses yeux dans les miens et en immobilisant ses mains d’ordinaires vagabondes et son quintal encombrant, avait été renversé par un camion sur la route qui coupe le village, le pauvre. A quelques uns, on l’a porté jusqu’au tombeau du Père Soulas, on l’y a allongé et on a prié.
Silence surréaliste, jamais Olivier ne se tait; il est guilleret la plupart du temps; ses fossettes égaient ses bajoues; il est le premier à s’esclaffer de ses blagues salaces. Là, il reste figé. Prie-t-il à sa façon? Ou ménage-t-il le suspense, en bon conteur méridional?
– Mon père a vécu dix ans de plus, en bonne forme, c’est un miracle du Père Soulas. Un Saint, cet Abbé.
C’est alors qu’un gros homme moustachu, qui attendait jusque là assis dans un vieux 4X4, claqua violemment la portière et franchit d’un pas lourd le seuil de l’épicerie. Une dame malodorante, derrière moi, patientait depuis un bon quart d’heure en écoutant Olivier chanter, téléphoner, philosopher. Elle n’était pas allée jusqu’à participer à notre conversation, elle se tordait les mains, qu’elle avait noueuses et craquelées, comme si elle souffrait ou surmontait à grand peine son impatience. Une jeune fille se tenait à ses côtés, aussi souriante que sa mère était sombre, aussi calme qu’elle paraissait agitée, aussi belle qu’elle était laide. Elle devait avoir mon âge, je ne l’avais encore jamais aperçue dans le village, je l’aurais remarquée. Olivier venait à peine de terminer sa phrase :
-…Père Soulas. Un Saint, cet Abbé.
Le gros moustachu, sans un bonjour, enguirlanda ma voisine :
– T’en mets un temps pour acheter trois bricoles!
Celle qui devait être sa femme se frotta les mains l’une contre l’autre avec une nervosité accrue. Son regard fixé sur Olivier désignait le coupable, sans qu’elle prononce un mot. Peine perdue si elle croyait culpabiliser l’épicier. Au contraire sans doute, cela l’inspira, il entonna une des chansons paillardes de son répertoire, sur fond d’orgue égrillarde que ses joues mimaient en se gonflant et en se dégonflant :
« Quand la boiteuse s’en va au marché,
Quand la boiteuse s’en va au marché,
Elle n’y va jamais sans son panier,
Elle n’y va jamais sans son panier
Elle s’en va le long de la rivière »
Le gros moustachu se tourna de trois quarts vers l’épicier et fit mine, gesticulations à l’appui- moustache frémissante, regard dominateur- d’engager le fer avec lui à propos de l’abbé Soulas. A première vue, son accent méridional prononcé n’atténuait en rien la sécheresse de ses paroles, la véhémence de son geste, la sévérité de son regard.
Apparences tout ça, l’épicier n’était pas dupe. Il répondit sur le même ton :
– Si t’es pas content, va voir ailleurs, Léon.
Là dessus, il reprit sa chansonnette, sans rougir un brin, les joues pleines du plaisir de choquer son public féminin.
« Quand il y a du cul, des fesses et du derrière
Ah jamais on n’a vu, mais jamais vu
Une boiteuse avec un si beau cul
Ah l’on ne verra plus, ne verra plus
Une boiteuse avec un si beau cul
Sur l’air du tra la la, sur l’air du tra la la
Sur l’air du tra la la, la la »
– Tra la la, tu peux chanter, va, reprit l’autre. Il a pas fait que du bien, ton abbé.
– Oh, mais c’est pas mon abbé, tu sais que je les aime pas, d’habitude, mais celui-là, c’est différent. Il était et il reste notre abbé à tous.
André et Germaine m’avaient prévenu : il y avait quelques mécréants dans ce village, Olivier était réputé en faire partie parce qu’il ne mettait jamais les pieds à l’église. L’hurluberlu véhément devait en être un autre, à en juger par sa réponse :
– Le nôtre, le nôtre, c’est vite dit! Pas le mien, en tout cas. Les curés, moins on les voit, mieux on se porte. Une fois à la naissance, une fois après la mort, ça suffit largement.
Il partit d’un grand éclat de rire qui souleva en cadence sa moustache et ses pieds, l’un après l’autre, entraînant l’épicier obèse dans sa danse. Ce qui avait commencé comme une dispute continuait en galéjade, les bajoues de l’épicier répondaient à celles du gros Léon, ils paraissaient unis dans leur détestation du clergé. La complicité des deux hommes, indifférents au public que nous formions, me sauta aux yeux malgré leur désaccord affiché à propos du Père Soulas. Cette fois, c’est Olivier qui enchaîna :
– Un Saint, ce Père, je te dis. Il a soigné nos vieux gratis, les tiens comme les miens, non?
Son regard moqueur disait assez le plaisir qu’il prenait à cet échange; la façon de parler, le ton, les mimiques comptaient plus que le fond du sujet, je le sentais.
– A nos vieux, oui, il a fait du bien. Pas aux jeunes enfermés là-bas.
Léon désignait du doigt un horizon proche, derrière les collines de Saugras.
J’ai eu tort de m’immiscer dans leur échange à ce moment-là.
– Quels jeunes? Où étaient-ils enfermés?
Je posai la question à brûle pourpoint.
Ah ces étrangers, ils connaissent rien à l’histoire du canton, voilà ce que leurs regards condescendants me renvoyèrent à l’unisson.
– C’est une longue histoire; elle date pas d’hier, hein, Olivier?
Le point d’interrogation n’était mis que pour faire illusion, son clin d’oeil appuyé en disait long. Léon tourna vers moi son quintal et donna la grosse caisse pour me ridiculiser à la cantonade :
– On a pas trop le temps de vous expliquer tout ça maintenant, pas vrai?
Cet homme n’était pas si gêné que je le croyais par sa corpulence. Comme s’il appuyait sur un bouton qui mettrait un ressort en mouvement, il se tourna d’un bloc vers son compère, heurtant du même coup sa femme du bras droit, qu’il n’avait pas si enveloppé que ça, elle laissa échapper un grognement.
– Allez, va, où tu la caches ta saucisse, gros voyou?
Les joues roses de l’épicier se tendirent davantage, si c’était possible.
– Ma saucisse, tu veux la voir, ma saucisse?
– Pardi!
– Tourne toi, té!
En même temps que son regard malicieux nous faisait entrer dans son jeu de scène, Olivier tendait le bras vers l’étagère, derrière la foule agglutinée, entre-temps l’épicerie s’était remplie. Léon choisit :
– La plus grosse pour moi; les trois petites, pour mes femmes.
Serait-il bigame?
Non, il se moquait de moi une fois de plus, j’étais le seul nouvel arrivant dans le groupe.
La jeune fille devait être sa fille, la pauvre! Elle avait une soeur, sans doute.
J’étais venu faire trois courses et repartais penaud mais le coeur palpitant après cette rencontre, même si j’ignorais tout d’elle.